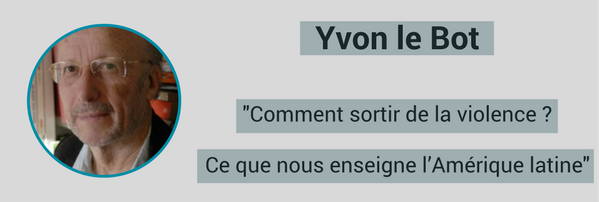
Yvon Le Bot : Ce que nous enseigne l'Amérique Latine sur la Sortie de la Violence

Membre du Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS, EHESS), Yvon Le Bot est sociologue et membre associé du Collège d’études mondiales (FMSH) et membre du comité de pilotage d’IPEV.
Comment sortir de la violence ?
Ce que nous enseigne l’Amérique latine
Introduction
L’Amérique latine passe pour un continent de violences, souvent extrêmes. C’est pourtant aussi une région qui, dans les dernières décennies, donne à voir le plus grand nombre d’expériences de sortie de violence à travers des négociations de paix, des transitions démocratiques, des mobilisations sociales et culturelles, des processus mémoriels.
Un champ prolifique dont on essaiera de dégager des problématiques, des thèmes susceptibles de nourrir des analyses transversales, et, si possible, une mise en perspective globale.
Je ne propose pas ici un panorama exhaustif, encore moins une étude aboutie.
Seulement un canevas, quelques entrées, quelques axes dont le fil commun est une approche par les acteurs et les logiques d’action.
Voici ces « entrées » (qui sont en l’occurrence des « sorties »):
- Sortie de la violence par la violence
- Sortie institutionnelle, politico-juridique
- Sortie par les mouvements sociaux
- Par les productions culturelles
- Et finalement, la question, qui traverse toutes les autres, de la mémoire, de l’Histoire et de l’oubli.
Une question liminaire.
Métamorphoses des violences.
Sortir des conflits armés pour entrer dans d’autres types de violences ?
Vu de l’extérieur l’Amérique latine a souvent encore l’image d’un continent de guérillas et de dictatures avec leur cortège de répressions sanglantes, parfois de terrorisme d’État. Sauf rares exceptions, les unes et les autres se sont éteintes depuis environ un quart de siècle. Toutefois, les traces et les effets des violences des années 60-90 sont encore présents, les blessures ne sont pas toutes cicatrisées. C’est en particulier le cas dans des pays qui ont connu des « guerres contre la société » comme celle livrée au Pérou par l’Etat d’une part, par Sentier lumineux de l’autre. Ou comme le génocide perpétré au Guatemala par l’armée et les paramilitaires.
Par ailleurs, la disparition des guérillas et des dictatures n’a pas signifié la fin des violences. Dans certains pays d’Amérique centrale (Guatemala, Salvador) le taux d’homicides est plus élevé aujourd’hui qu’à l’époque des conflits armés internes.
Les violences révolutionnaires et contre-révolutionnaires ont laissé place à des violences où se mélangent, à des doses variées, dimensions politiques et mafieuses. En Colombie la transformation s’est opérée à partir des années 80 au sein même du conflit armé, ce qui est l’une des raisons de sa prolongation jusqu’à nos jours.
Dans l’ensemble de la région, on est entré dans une période dominée par l’imbrication du crime organisé, de la finance globale et de la corruption politique généralisée. Dans les nouvelles violences, le pouvoir d’Etat n’est plus l’enjeu central. Le principal ressort est le contrôle du narcotrafic et d’autres formes de trafic (dont celui des migrants), ainsi que des flux financiers. S’y affrontent des groupes mafieux, des organisations politiques et économiques corruptrices et corrompues. Les mafias s’inscrivent dans des réseaux transnationaux et gangrènent le tissu social, le système économique et politique. Cartels mexicains, maras (gangs d’adolescents ultraviolents) en Amérique centrale, diverses organisations criminelles au Brésil.
Les massacres dans les prisons comme celui qui vient d’avoir lieu à Manaus et comme ceux qui ont lieu de manière récurrente en Amérique centrale (Honduras en particulier) relèvent de ce registre de violences.
Amérique latine/Moyen-Orient: ressemblances et différences
Les violences extrêmes qui se déploient ou qui se sont déployées dans la région peuvent éclairer par un jeu de miroir celles qui ont lieu au Proche et Moyen-Orient, en Afrique et en d’autres régions du monde.
Plusieurs auteurs (Olivier Roy parmi eux) ont signalé des points communs, des ressemblances, dans les modes de recrutement, les modalités d’action, les stratégies de la terreur. Comme les cartels mexicains, Daesh, Boko Haram, AQMI mélangent violence paroxystique exhibitionniste et trafics en tous genres.
Toutefois la problématique de la radicalisation et de la déradicalisation telle qu’elle est mise en œuvre dans les études sur le djihadisme ne semble pas s’appliquer aux expériences latino-américaines.
Entre la violence révolutionnaire et le terrorisme d’aujourd’hui, entre le guévarisme par exemple et le djihadisme, il y a une différence essentielle, bien mise en évidence par Baudrillard dans son texte sur le 11 septembre 2001 : les violences révolutionnaires, écrivait-il, visaient à transformer le monde, « l’énergie qui alimente la terreur (…) vise à le radicaliser par le sacrifice ».
La terreur des narcotrafiquants relève encore d’une autre logique : elle ne vise ni à transformer ni à radicaliser le monde ; elle n’est pas portée par l’idée de sacrifice. Et la sortie des violences politico-mafieuses se pose aussi en termes différents, plus compliqués et incertains que la sortie des conflits armés de la période précédente. Mais des négociations ne sont pas impossibles, elles ont eu lieu parfois au grand jour, plus souvent clandestinement, en Colombie avec Pablo Escobar et surtout le cartel de Cali, en Amérique centrale avec les maras, au Mexique avec certains cartels contre d’autres.
Mais la typologie que je propose dans la suite se réfère en priorité à des situations de violences à dominante politique.
J’isole quatre types pour les besoins de l’analyse. Dans les faits, ils sont le plus souvent entremêlés.
Premier type.
La sortie institutionnelle. La voie politico-juridico-diplomatique.
C’est la sortie la plus classique, le champ le plus exploré. Celui pour lequel il existe la plus abondante littérature :
a – L’interrogation qui est au centre de tous les processus de paix, de toutes les opérations de peacemaking ou peacekeeping, ou quasiment toutes, est celle-ci: comment passer de l’action armée à l’action politique ?
Dans l’Amérique latine des dernières décennies, certains conflits armés se sont terminés par la défaite, voire l’écrasement de l’un des protagonistes, sans négociation. En général la défaite des guérillas : Guevara en Bolivie, les Tupamaros en Uruguay, les Montoneros en Argentine, Sentier lumineux au Pérou, etc. etc… Il y a deux cas seulement de défaite du pouvoir en place, sans négociation là non plus : Cuba et le Nicaragua.
Mais la région offre aussi un grand nombre de processus de paix négociée : en Colombie depuis les années 80 jusqu’aux récents accords de paix avec les FARC. En Amérique centrale dans les années 80-90 : Nicaragua, Salvador, Guatemala mais aussi le Chiapas au Mexique.
On considère en général qu’en Amérique Latine le passage des conflits armés à la politique a été globalement réussi. Dans aucun des cas mentionnés il n’y aurait eu rechute.
Pour certains analystes c’est parce que, contrairement à d’autres régions du monde, il s’agissait ici de conflits politiques sans fond ou arrière-fond culturel, religieux, ethnique ou racial.
Mais, même limitée à l’Amérique Latine, cette hypothèse, globalement pertinente, gagne à être nuancée :
- la Colombie par exemple présente des cas qui la vérifient (accords de paix avec le M19 et d’autres groupes de guérilla en 1990-91), mais aussi un cas important qui la contredit, au moins pour un temps : les premiers accords avec les FARC dans les années 80 ont été balayés par une vague de violences homicides, qui a entraîné une reprise de la lutte armée.
- D’autre part, les éléments culturels, religieux et ethniques ou raciaux étaient très présents dans la guerre au Guatemala, jusqu’à lui donner une connotation génocidaire.
Autre constat. Dans des sociétés très divisées, et dont les divisions ont été accentuées et mises à vif par le conflit, les processus de paix gérés d’en haut, par des acteurs institutionnels, des politiques, des militaires, des chefs guérilleros, des professionnels de la négociation, courent le risque d’être désavoués par une majorité ou une bonne partie de la population.
La victoire du NON au referendum du 2 octobre dernier en Colombie n’est pas un événement inédit ni totalement surprenant. Une chose semblable s’est passée au Guatemala en 1999 lors du referendum sur les accords de paix de 1996, et cela a beaucoup influé sur la tournure très décevante qu’a prise la période de post-conflit dans ce pays.
- b) Aux processus de paix sont directement liées des questions que, faute de temps, je vais simplement énumérer mais qui seront des thèmes obligés de nos travaux:
D’abord la thématique connue sous l’appellation DDR: démobilisation, désarmement, réintégration.
Ce sont des questions qui occupent spécialement les experts, les organisations internationales, les ONG… Elles ont toujours de fortes implications et conséquences politiques, sociales et culturelles.
Un autre domaine que l’Amérique latine partage avec l’Afrique notamment, est celui de la justice transitionnelle. Humberto de la Calle, chef de la délégation du gouvernement colombien aux négociations avec les FARC affirme que ça a été le point plus épineux, le plus difficile, le plus long à négocier de tous ceux qui étaient sur la table à La Havane.
Mentionnons aussi les procès pour crimes de guerre et pour crimes contre l’humanité, qui dans les dernières décennies ont concerné surtout les Balkans et l’Afrique, mais dont il existe aussi des exemples en Argentine, au Chili, en Colombie, au Guatemala…
Parmi les acteurs institutionnels des processus de paix, une catégorie s’inscrit très directement dans la perspective de notre panel, celle des acteurs internationaux ou transnationaux : groupes d’Etats, organismes des Nations unies, Tribunaux internationaux, Églises, ONG… Experts de divers types et de différentes appartenances institutionnelles.
Enfin, on a déjà évoqué la notion très élastique de post-conflit. A condition de s’entendre sur sa délimitation, on pourrait en faire un champ d’étude particulier, tant la sortie de la violence peut s’étaler dans la durée – une, deux, trois décennies après la fin du conflit.
A ce propos, en Amérique latine on cite souvent cette phrase d’un ancien guérillero salvadorien : « Ganamos la paz, pero perdimos el pos-conflicto ». Je propose de lui substituer celle-ci, qui me semble plus pertinente, plus adaptée à la majorité des situations: « Nous sommes sortis de la guerre, mais nous n’avons pas bâti la paix ».
Deuxième type.
Sortie de la violence par la conflictualité sociale, par les acteurs sociaux.
Les conflits armés ne sont pas le prolongement des conflits sociaux. Ils résultent plutôt de leur impossibilité ou de leur rupture, et la violence détruit les mouvements sociaux.
Peut-on cependant sortir de la violence ou l’éviter par la voie du mouvement social ou culturel ?
Les expériences latino-américaines en ce domaine dessinent des figures variées, que l’on pourrait tenter de classer selon qu’elles sont antérieures, contemporaines ou postérieures aux périodes de violence.
a) Les mouvements qui se réclament expressément de la non-violence sont rares sinon inexistants dans la région.
En revanche, on y observe de multiples actions collectives concrètes de prévention, d’évitement, d’esquive, de contournement de la violence.
Les meilleurs exemples sont des mouvements indiens, qui se sont efforcés de ne pas entrer dans la logique de la lutte armée, et qui y sont parfois parvenus.
b) Une deuxième figure consiste en des mobilisations de la société civile visant à contrer, à résister, à freiner, à enrayer l’engrenage des violences, ou à s’y soustraire.
Une illustration forte: la mobilisation massive à Mexico en janvier 1994 réclamant l’arrêt des hostilités après le soulèvement zapatiste au Chiapas. Elle a grandement contribué à stopper la répression et à infléchir l’insurrection armée dans le sens d’un mouvement civique.
c) Les expériences latino-américaines de recomposition de conflits sociaux après les conflits armés en illustrent toute la difficulté.
Là où ont déferlé les violences extrêmes et la terreur, les mouvements sociaux ont le plus grand mal à renaître. Les politiques de terre brûlée ont eu des effets à long terme. Le Guatemala et le Pérou en sont les meilleurs exemples (ou plutôt les pires).
Parfois il faut une, deux ou plusieurs générations avant qu’émergent de nouveaux conflits, de nouveaux acteurs sociaux.
Ça a été le cas avec le « printemps chilien » de 2011-2012.
Le Chili illustre assez bien une alternative, un dilemme récurrent: transition politique ou conflictualité sociale ?
Pour les tenants d’une sortie exclusivement politique, la renaissance des conflits sociaux risque de mettre en péril la transition démocratique et de provoquer une rechute dans la violence.
Une bonne partie des secteurs dirigeants et de la société chilienne a intégré le récit pinochettiste selon lequel ce sont les mobilisations de la période Allende qui ont provoqué, en réaction, le coup d’Etat et que le maintien de la démocratie et de la paix sociale exige de contenir voire de réprimer les mouvements sociaux.
Des lois et des décrets édictés sous la dictature ont continué ainsi à être utilisés dans la période démocratique contre les acteurs sociaux, les Indiens Mapuche notamment. C’est contre cette situation et la logique qui la sous-tend que s’est soulevée la jeunesse chilienne en 2011-2012.
Troisième type
Sortir de la violence par la création culturelle.
Les actions sociales de sortie de la violence s’accompagnent souvent de productions culturelles. Les deux dimensions sont imbriquées. Mais il est aussi des situations où la production culturelle est relativement séparée de l’action sociale, ou bien l’emporte sur celle-ci. Ce sont des mouvements plus proprement culturels du fait de leurs acteurs, des modalités d’expression, des œuvres…
Andrea Grieder nous a présenté il y a quelques jours son travail au Rwanda, une transformation des traumatismes du génocide par la poésie. Des ateliers et des performances qui mettent en œuvre le pouvoir cathartique et de sublimation de la création poétique. Trouver des mots pour dire l’indicible et pour tenter de tenir l’horreur à distance.
A l’inverse, après l’assassinat de son fils et des amis de celui-ci, le poète mexicain Javier Sicilia a pris la décision de renoncer à la poésie et de se consacrer à l’action, à la lutte contre le déferlement de violences au Mexique, à travers le « Mouvement pour la paix avec justice et dignité ».
Cependant au Mexique, comme au Chili, comme en Colombie, la production culturelle est également mobilisée dans le combat contre la violence et contre l’oubli.
Les processus mémoriels
Il y a une question qui mérite qu’on lui fasse une place à part : celle de la mémoire, de l’Histoire et de l’oubli, pour reprendre le titre d’un livre de Ricœur.
Ce thème traverse et imprègne tous les types et modalités de la sortie de la violence dont il a été question.
Mais il y a lieu de prêter une attention particulière à des expériences, qui mettent expressément au centre les processus mémoriels.
- Les commissions de la vérité et de la réconciliation, les centres de la mémoire historique, dont on trouve de nombreux exemples en Afrique (le plus connu est celui de l’Afrique du Sud) et en Amérique latine : Argentine, Chili, Guatemala, Pérou, Colombie.
- Les musées de la mémoire, expériences plus aléatoires (Chili, Pérou, et un projet en Colombie).
- Les procès pour crimes contre l’humanité déjà mentionnés. Ils ont également leur place ici tant il est vrai comme l’affirme Sophie Daviaud que l’une de leurs principales fonctions est de mettre en récit les mémoires, de produire une mémoire collective de la violence.
- Les pratiques d’exhumations de charniers. Valérie Robin et Anne-Marie Losonczy viennent de consacrer un livre à ce phénomène en Amérique latine et en Espagne. « L’objectif de ces exhumations, écrivent-elles, est triple: rendre leur dignité aux défunts, apaiser leurs familles et permettre la réconciliation nationale ».
Je ne peux pas terminer sans dire quelques mots sur les mouvements pour les disparus, pour la mémoire, contre l’oubli, particulièrement importants en Amérique latine.
Des organisations et des mobilisations de ce type ont vu le jour dans les pays qui ont connu des dictatures et des guérillas, ainsi que dans ceux qui ont été frappés par des violences politico-mafieuses, c’est-à-dire au total dans presque tous les pays de la région.
Les femmes y jouent un rôle capital.
Tout le monde a entendu parler des associations des mères et grands-mères de la place de mai à Buenos Aires.
Des associations de victimes ou de parents de victimes, souvent autonomes, parfois liées à des ONG ou à des Eglises se sont développées depuis les lendemains du coup d’Etat de Pinochet en septembre 1973, jusqu’aux mouvements pour les disparus d’Ayotzinapa, les étudiants victimes du massacre de septembre 2014 dans l’Etat de Guerrero au Mexique. En passant par le Pérou, la Colombie, l’Amérique centrale.
Les notions même de « disparus », « desaparecidos », « détenus-disparus », « disparitions forcées » ont été sinon inventées du moins développées et précisées à partir de ces luttes (au Chili, en Argentine, en Uruguay) en liaison avec des ONG (comme Amnesty International), des juristes et instances internationales.
Une interrogation.
Ce texte est une ébauche, il n’appelle pas vraiment de conclusion.
Je m’en tiendrai à une seule observation, en fait une question qui court en filigrane tout au long de mon exposé :
Sortir de la violence suppose de sortir de la victimisation, passer du statut de victime à celui d’acteur. Comment s’ériger en acteur devant les violences extrêmes, contre des forces qui détruisent toute capacité d’action, les fondements de la vie en commun, l’idée même d’humanité ?
